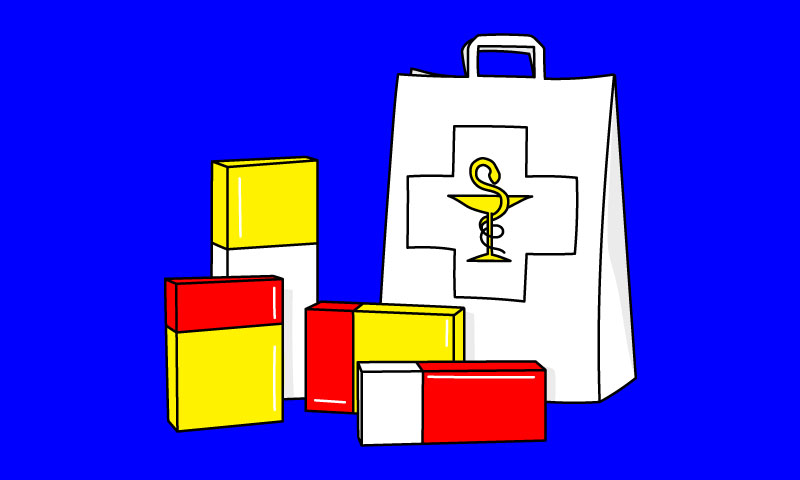
Comment parvenir à un panier de soins remboursé de qualité
Optique, dentaire, audition : quelles sont les combinaisons possibles pour proposer un panier de soins de qualité intégralement remboursé ? C’est à cette question que cette synthèse du Lab s’attache ici à répondre.
La volonté de proposer une offre à reste à charge nul dans les champs de l’optique, du dentaire et de l’audition est l’occasion de questionner plus largement l’efficience de notre système de santé.
Il s’agit, à travers l’efficience, d’interroger le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour les atteindre, ou plus exactement la capacité à produire le maximum de résultats avec le minimum de moyens. Cette réflexion est d’autant plus nécessaire dans un contexte budgétaire contraint.
La ministre s’est en effet engagée à proposer le remboursement intégral d’un panier de soins nécessaires et de qualité. Or, il serait regrettable, pour l’ensemble de la collectivité, que ce panier ne réponde pas de façon pertinente aux besoins de santé. Pire encore, si le panier défini ne correspondait à aucune attente sociale. Actes redondants ou inutiles, et non-qualité des soins sont autant de situations générant des coûts que la société ne devrait pas avoir à endosser. Concrètement, comment accepter qu’entre 20 et 30% des dépenses d’assurance maladie puissent être considérées comme non-pertinentes ? N’est-ce pas mettre en risque, et les patients, et la soutenabilité du système tout entier ?
Répondre à ces questions passe par une analyse fine de l’organisation et des modèles économiques des trois secteurs de l’optique, du dentaire et de l’audition. Au total, ce sont donc 18,3 Md€, à savoir les grands équilibres, en cumulés, de ces trois filières, qui méritent d’être mis en débat, la suite n’étant que choix politiques : à partir de quel instant juge-t-on une prise en charge efficiente ? Et qui dispose de la légitimité nécessaire pour déterminer ce qui est efficient de ce qui ne l’est pas ? Autant d’interrogations qui structureront régulièrement le débat public, du fait des surcoûts liés à l’essor de traitements toujours plus personnalisés et à l’afflux d’innovations, en cancérologie notamment.
Comment définir « l’efficience en santé » ?
En santé comme ailleurs, plusieurs combinaisons apparaissent possibles pour trouver le juste point d’équilibre entre coût et qualité.
Il peut s’agir de réduire le coût, sans diminuer la qualité. Pour certains, le low cost, même s’il suscite beaucoup d’appréhension chez les Français et en dépit de la vision péjorative qu’il suscite, pourrait tout à fait s’appliquer au monde de la santé. Il s’agirait de favoriser l’émergence d’acteurs revendiquant un minimalisme poussé à l’extrême : le patient se verrait promettre un « service essentiel », en échange d’un prix plus faible et d’une optionalisation des fonctions secondaires. Des entreprises comme Sensee, Happyview ou Lunettes pour tous dans le domaine de l’optique sont au nombre de ceux-là, autour d’une double ambition : refuser la surqualité pour s’adapter aux nouveaux comportements des patients ; bousculer les opérateurs installés et les obliger à se révolutionner eux-mêmes.
L’efficience peut aussi consister à accroître la qualité, via une augmentation des coûts. La démarche d’investissement social part de cette idée. Cette stratégie vise à faire face aux évolutions des risques sociaux, à mieux préparer et accompagner les individus tout au long de leur parcours de vie, afin d’avoir moins à réparer si le risque survient. Concrètement, tous les acteurs seraient invités à agir le plus en amont possible pour éviter les retards de prise en charge et les phénomènes de sous-consommation de soins (renoncement, report, etc.). Investissement dans la jeunesse, valorisation de la prévention à tous les âges de la vie, optimisation, voire prédétermination, du parcours de soins et prise en charge précoce des âgés sont autant d’éléments susceptibles d’instaurer un cercle vertueux, permettant de limiter les dépenses sociales, donc d’accroître les ressources disponibles, en favorisant le bien-être de tous dans les meilleures conditions.
En santé comme ailleurs, plusieurs combinaisons apparaissent possibles pour trouver le juste point d’équilibre entre coût et qualité.
Enfin, il peut s’agir d’accroître la qualité, sans économie, ni dépense supplémentaire. Pour cela, il faudrait parvenir à expliciter les priorités de prise en charge. Une manière de prioriser les choix serait de procéder, dans la mesure du possible, à un classement de l’ensemble des traitements disponibles selon le gain en santé que chacun procure, rapporté à son coût. Plusieurs mesures d’impact seraient envisageables : elles devraient tenir compte de la réduction de mortalité, de l’amélioration de la qualité de vie et de la réduction des invalidités. Pour les trois secteurs traités, l’amélioration de la qualité de vie serait plus particulièrement concernée. Fortement controversée, la méthode coût-efficacité basée sur les QALYs est l’une des approches possibles.
QALYs : de quoi parle-t-on ?
L’approche coût-efficacité fondée sur les QALYs (Quality Adjusted Life Years) sert à fonder des arbitrages entre différents traitements permettant d’améliorer la santé. Les gains de santé sont quantifiés en termes d’années de vie gagnées, pondérées par leur qualité. Sur cette base, deux options sont possibles : définir un seuil acceptable de coût par QALY, et inclure dans le panier tous les soins dont le ratio coût-efficacité est inférieur à ce seuil ; prioriser les traitements en fonction du budget disponible une année donnée. Concrètement, chaque année de vie est pondérée par un coefficient compris entre 0 et 1 exprimant, depuis l’état de parfaite santé correspondant au coefficient 1, toutes les gradations de mal-être croissant jusqu’à la mort correspondant au 0. Un traitement A, qui coûterait 20.000 euros par patient et permettrait de gagner en moyenne 1 QALY, aura un ratio de 20 000 euros par QALY ; un traitement B, qui coûterait 10 000 euros pour un bénéfice moyen de 0,1 QALY, aurait un ratio de 100 000. Dans cet exemple, on voit qu’avec un budget total de 1 million d’euros, on peut choisir de traiter cinquante patients par le traitement A, ce qui induit un gain total de santé, pour la population, de cinquante années de vie en bonne santé ; alternativement, on peut choisir de traiter 100 patients par le traitement B, mais ce choix ne produirait que dix années de vie en bonne santé. Le traitement A doit donc être préféré au traitement B, car son ratio coût-efficacité est plus favorable.
Mais que l’on s’oriente vers l’une et/ou l’autre de ces options, une question préalable doit être posée : comment évaluer la qualité d’une prise en charge, en particulier dans les secteurs de l’optique, du dentaire et de l’audition ?
Qui pour définir la qualité en santé ?
L’OMS définit la qualité en santé comme un acte qui assure « le meilleur résultat en termes de santé conformément à l’état de la science, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour la plus grande satisfaction en termes de procédures ». Pour juger de la qualité, il faut donc distinguer l’acte en lui-même, son opportunité (le besoin diagnostiqué) et sa conformité effective avec la prescription (ordonnance, plan de soin, etc.) qui en découle ; les conditions de son efficacité et de sa sécurité qui combinent compétences professionnelles, qualité de l’environnement technique et des dispositifs médicaux, respect des normes réglementaires ; ses effets sur le besoin, son efficacité objective et ressentie.
Reste que, pour les trois secteurs concernés, les prix sont fixés librement et sont déconnectés des tarifs de remboursement. Autrement dit, les tarifs déterminés par la Sécurité sociale sont sans rapport avec le coût réel de la prise en charge pour le patient. Ils ne sont pas davantage conformes à un quelconque besoin de santé.
Par ailleurs, ces trois secteurs se caractérisent par la faiblesse, voire par l’absence de référentiels de bonnes pratiques et d’indicateurs de qualité et même, selon les cas, de moyens d’assurer la traçabilité des produits installés. Les patients sont donc régulièrement laissés à eux-mêmes et dans l’incapacité de faire jouer la concurrence entre les différents types d’acteurs.
Sans doute, à terme, l’amélioration de la transparence sur les résultats des structures et/ou des professionnels permettra-t-elle d’éclairer les patients sur les facteurs de risque et sur le choix de leur parcours de soins. D’autant que ces mêmes patients se trouvent déjà de plus en plus sollicités pour exprimer leur satisfaction quant à leur prise en charge en santé. Sur le modèle du médicament, ne serait-il d’ailleurs pas possible d’imaginer un dispositif de déclaration d’effets indésirables, afin de détecter rapidement les offres jugées de mauvaise qualité ?
Dans l’attente, les pouvoirs publics doivent résolument s’engager dans l’amélioration de la régulation par la qualité, à travers des mesures de cette qualité, la production d’évaluations médico-économiques et de référentiels de prise en charge plus directement applicables par les professionnels. A condition d’asseoir leur légitimité dans le système de santé, les politiques de conventionnement avec les professionnels de santé constituent également un excellent moyen de gérer les risques et de maîtriser la dépense, tout en jouant le rôle de tiers de confiance pour les patients.
Les patients sont donc régulièrement laissés à eux-mêmes et dans l’incapacité de faire jouer la concurrence entre les différents types d’acteurs.
Plus largement, poser la question de la qualité en santé et de son coût pose d’autres difficultés.
D’abord, il s’agit d’un bien singulier, au sens donné par Lucien Karpik. Son prix n’est pas un vecteur de choix et ne constitue pas nécessairement un signal marchand de la qualité. En effet, lorsque l’on s’adresse à un professionnel, la meilleure santé n’est qu’une promesse, dont l’évaluation de la qualité est forcément différée. Le patient n’est donc jamais certain de se prémunir totalement des risques d’erreurs et de mauvais choix, même en mobilisant un niveau élevé de connaissances.
Ensuite, la santé est également un bien intrinsèque, au sens donné par James Frey. Parce qu’elle a beaucoup de valeur, elle ne peut avoir de prix. Par exemple, que peut coûter une prise en charge qui me libère d’une douleur ? Ou qui peut chiffrer un don de sang ?
Autant d’éléments qui complexifient tout exercice de corrélation entre ce qui serait des soins de qualité et la détermination de leur « juste coût ».
Un tel constat est contraignant pour l’ensemble des acteurs de l’optique, du dentaire et de l’audition, car tous se trouvent dans l’impossibilité de démontrer, de façon objectivable, ce qui différencie l’une ou l’autre de leurs pratiques, l’un ou l’autre des professionnels. Toutes les formes d’autopromotion de la qualité sont susceptibles d’être jugées partiales, voire suspectes. Au détriment, en définitive, des patients, qui ne sont jamais certains de bénéficier, lorsqu’ils s’orientent dans le système de santé, du juste soin au juste prix, où qu’ils vivent.
Seule, l’objectivité d’autorités scientifiques, telles la Haute Autorité de Santé, semblerait à même d’assurer de telles missions. Et seul, l’approfondissement des politiques de rémunération à la performance – sur objectifs de santé publique par exemple – serait à même de valoriser les bonnes pratiques des professionnels. Les financeurs (Assurance maladie, mutuelles, ménages), sous réserve d’un cadre adapté, ont donc un véritable rôle à jouer dans la régulation du système de santé par la qualité.